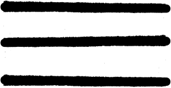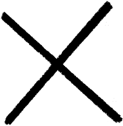Victor Roussel : 66 jours est un spectacle dans lequel vous parlez au public, d’une manière directe et dépouillée. En passant sur un grand plateau avec Zoé [et maintenant les vivants], et en partageant la scène avec deux autres interprètes, comment vous êtes-vous posé la question du rapport aux spectateurices ?
Théo Askolovitch : Le premier lien que je vois entre les deux spectacles, plus que la forme ou que l’adresse, c’est vraiment l’écriture autofictionnelle. Je pars de mon vécu pour en faire un récit, je me raconte au plus près avec l’espoir de raconter le monde. 66 jours est en effet un dialogue entre un comédien et le public. Tout le spectacle est comme une confession, un récit adressé directement aux spectateurices. Ça m’a confirmé que, dans le théâtre que je veux faire, la notion de quatrième mur n’existe pas. J’aime faire en sorte qu’on n’oublie jamais que nous sommes en train d’assister à une représentation. Et pour que ce jeu fonctionne, le public doit toujours avoir un rôle central. Si Zoé [et maintenant les vivants] est un trio, et que l’adresse change évidemment, les trois interprètes ont toujours la conscience de la scène, du public, du moment présent. Dans le spectacle, il y a différentes formes narratives qui s’entremêlent, mais je continue de diriger les interprètes de manière à ce qu’iels restent dans l’urgence de raconter, dans une sorte d’instabilité, pour que le public se sente directement concerné. Avec la comédienne Marilou Aussilloux, nous avons d’ailleurs pensé la scénographie dans cet esprit : c’est une page blanche où tout s’écrit avec le public. Je ne voulais pas faire de décor en arrière-plan, qui nous donne l’illusion que nous ne sommes pas au théâtre. Tous les éléments du plateau doivent faire partie du récit.
V.R. : Vous jouez 66 jours en salle de classe. Comment les regards des jeunes spectacteurices vous accompagnent ?
T.A. : Franchement, leur regard ne ment pas, il a beaucoup moins de filtres que le regard des adultes. C’est le public le plus révélateur, le plus exigeant, surtout sur l’émotion. Au début, j’étais tétanisé à l’idée de jouer devant une classe de 30 élèves, j’aurais préféré jouer devant un stade entier. Mais j’ai tout de suite été très touché de voir qu’iels se sentaient représenté·es, que je pouvais créer un spectacle en partageant les mêmes codes de pop culture, de langage...
V.R. : Quelle place donnez-vous au rythme, à la musique, dans votre écriture et votre mise en scène ?
T.A. : C’est vraiment super important, d’abord parce que le rythme est crucial pour l’humour. Pour que mes spectacles ne soient pas seulement nombrilistes, il faut cette urgence de raconter, que la parole semble en avance sur la pensée : le débit rapide, se perdre puis se retrouver, le rythme qui parfois se déstructure pour ensuite retomber sur ses pattes, comme une réflexion qui digresse puis se rattrape... Et puis la musique a une place très importante dans Zoé [et maintenant les vivants], c’est une forme de narration, un personnage.
V.R. : Votre langue semble aussi travaillée par une musicalité très contemporaine...
T.A. : La langue de 66 jours sonne très urbaine car c’est l’histoire d’un mec de 20 ans qui tombe malade. Mais je veux faire attention à écrire une langue contemporaine sans me retrouver piégé par les stéréotypes du « parlé rap ». Après, les artistes contemporains qui me touchent le plus dans l’écriture, ça reste PNL. Ils ont cette faculté poétique, brute et directe, de créer des images très fortes en quelques mots. Je retrouve cela chez les auteurs dramatiques que j’aime beaucoup, comme Jean-Luc Lagarce ou Wajdi Mouawad.
V.R. : Dans Zoé [et maintenant les vivants], le rythme est aussi créé par le passage d’un type de narration à l’autre, par l’alternance entre monologue et dialogue, parfois même par différentes versions d’une même scène…
T.A. : Dans le spectacle, il y a trois formes narratives différentes : une adresse directe au présent, où nous jouons avec le spectacle en train de se faire, des scènes entre les comédiens, et des flashbacks. Pour dire la famille, j’aimais l’idée du puzzle, de différentes versions qui se confrontent et parfois s’emboîtent. Je voulais travailler sans personnage central, que puisse exister le prisme de chacun·e, son propre rapport à la mémoire. La vérité d’un souvenir n’est jamais qu’une vérité subjective, personnelle. La famille, c’est peut-être d’abord cela : la coexistence de plusieurs versions d’un même récit. Pour traverser le deuil et se reconstruire, il s’agit d’accepter que nous n’avons pas vécu la même chose, que nous n’avons pas la même manière de raconter l’histoire.
V.R. : Dans 66 jours, comment le football est arrivé ?
T.A. : Dans 66 jours, je raconte mon cancer des testicules. J’ai écrit le texte pendant le confinement, car le sentiment d’enfermement me rappelait mon séjour à l’hôpital. Je l’ai écrit en trois semaines, souvenir par souvenir, sur mon téléphone ou sur l’ordinateur, la nuit, sans avoir l’idée d’en faire un spectacle. Je ne me prétendais pas du tout auteur de théâtre, et cela a donné une dramaturgie non linéaire, pleine d’allers et retours. Mais quand je suis arrivé à la fin de l’écriture, j’ai eu le sentiment qu’il manquait une sorte d’histoire parallèle à laquelle s’accrocher, une histoire comme un miroir, un fil rouge... J’ai pensé à Ulysse, à l’Odyssée. Mais quand j’ai appelé mon père pour lui en parler, il m’a demandé si je l’avais lu, je lui ai répondu que non, alors il m’a dit que ce n’était pas une bonne idée, qu’il fallait que je trouve une histoire plus proche de moi. Que plus je me racontais sincèrement, plus le texte parlerait aux spectateurices. Donc j’ai arrêté de tricher : j’adore le football et j’ai revu le documentaire sur la victoire des bleus à la coupe du monde 2018. La manière dont Didier Deschamps, dont les joueurs, parlent de la compétition, de la résilience, de l’objectif de victoire, tout cela a résonné avec mon combat contre la maladie.
V.R. : Est-ce que le football reste une source d’inspiration dans votre écriture ?
T.A. : Oui, tout à fait. Pour moi, le foot est plus qu’un sport, plus qu’un divertissement. Il fait partie de ma vie, il a forgé mon regard politique et social. Je trouve passionnant ce qu’il se passe dans les tribunes. Comme dans le théâtre antique, on vient de plein d’univers différents et on va au match pour être ensemble, pour ressentir collectivement, et pas seulement pour regarder passivement ce qu’il se passe sur le terrain. Avant même d’être performant, un club comme le Red Star à Saint-Ouen est populaire, festif, joyeux. Ce qui est la base d’une lutte sociale. Et cela me parle aussi d’héritage : comme beaucoup d’autres, mon amour pour ce club, je le tiens de mon père et de mon grand-père… Être supporter, je trouve ça magnifique. Bien sûr, le football est devenu un business. Mais toujours, dans les tribunes, des groupes de supporters se battent pour garder ce sport accessible. Le Red Star est une véritable institution, ce club porte la mémoire de la ville, de la cité qui surplombe le stade, du passé ouvrier de Saint-Ouen, des luttes antifascistes et communistes. Franchement, pour toutes ces raisons, le Red Star pourrait être subventionné par les pouvoirs publics.
V.R. : Pasolini décrivait aussi le football comme l’ultime représentation sacrée, poétique et populaire de notre temps... Jeu avec la représentation, match de football, cérémonie juive du deuil de la Shiva : les rituels ont une place importante dans votre travail ?
T.A. : Ce que je trouve super beau dans les rituels, c’est que même sans être croyant, le sentiment d’appartenance reste très rassurant. Que ce soit le foot qui m’accompagne dans la maladie ou les coutumes de la religion juive qui m’aident dans le deuil. Dans Zoé [et maintenant les vivants], le rituel peut être vécu à la fois comme une contrainte et comme un accompagnement. Pour ponctuer le jeu très direct, je voulais que les chants, les images, créent des moments plastiques, très léchés. Mais je crois que j’essaye aussi de déconstruire les rituels que je représente, je ne les explique pas, ils ne créent jamais de communauté très claire, très cohérente...
V.R. : Depuis l’écriture cathartique jusqu’à la naissance de la fiction, comment abordez-vous les émotions ?
T.A. : Je trouve essentiel d’éviter le pathos, mais aussi le potache. J’essaye de faire tout un travail sur les trajectoires émotionnelles, qu’une scène s’arrête au bon moment, se rattrape avant d’aller trop loin, et qu’à d’autres moments on plonge vraiment, parfois sans s’y attendre. Mes spectacles ne sont pas une thérapie, je me raconte pour pouvoir me mettre en rapport avec le monde, avec les autres, avec des thèmes qui concernent tout le monde. En faisant un spectacle sur le deuil, j’ai l’impression de raconter les gens à un moment de vérité. D’ailleurs, le mot de réparation n’est pas si juste. Le mot reconstruction est plus intéressant, car la faille, la blessure, apparaît toujours. Comme le fil d’or du kintsugi ¹.
¹ Le kintsugi (« jointure en or ») est une méthode japonaise de réparation des porcelaines ou céramiques brisées au moyen de laque saupoudrée de poudre d’or. Philosophiquement, c’est reconnaître la brisure et la réparation comme faisant partie de l’histoire de l’objet, plutôt que la dissimuler.*