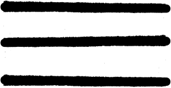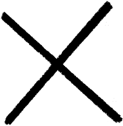Laure Dautzenberg : Après The Power (of) The Fragile, où vous dansiez en duo avec votre mère, vous poursuivez un travail « historique » en mettant au jour les strates de mouvements présents dans votre corps. Pourquoi cet intérêt persistant pour la manière dont la danse se noue à l’histoire ?
Mohamed Toukabri : Quand je travaille sur un projet, les questions qui me traversent sont toujours liées à ma trajectoire personnelle et à ce qui se passe dans le monde. Comme le dit Nina Simone, le devoir de l’artiste est de refléter son époque. Dans cette perspective, le personnel est politique et universel, car nous ne vivons ni ne dansons dans l’isolement : nous sommes toujours en relation avec l’Histoire, le monde, les autres et les systèmes qui le traversent. Je développe et amplifie certaines de ces questions personnelles, afin qu’elles se connectent à des enjeux plus larges. Après 23 ans de pratique de la danse, j’ai senti le besoin de faire une pause, de réfléchir à ce que j’ai traversé. J’ai donc approché mon corps comme un archéologue, en allant fouiller dans le corps-mémoire les différents couches d’histoires, de langages de danse que je porte. Ces langages m’ont été transmis, soit dans des cadres institutionnels, soit de façon plus directe, comme la culture hip hop, le breakdance, ce par quoi j’ai commencé.
Ce désir correspond aussi à des échanges avec des collègues, danseurs, artistes qui traversent les mêmes questions. Un livre m’a ainsi beaucoup inspiré : Mémoire de la plantation : Épisodes de racisme ordinaire de Grada Kilomba, artiste portugaise qui a vécu au Brésil et qui est maintenant basée à Berlin. Dans ce livre, elle parle de la question de la production de savoir. Elle questionne qui le produit, qui a le droit de le produire, avec l’idée que, pour elle, l’acte d’écrire est un acte de transformation, où elle n’est plus l’objet mais devient le sujet. Elle prend en charge elle-même son histoire avec l’idée que cette histoire peut être interrompue pendant un temps, appropriée et transformée. Je pense qu’on est dans un moment où ma génération a besoin de mettre en question l’histoire et la manière dont on la porte, l’effet de ce passé sur notre présent. Et si l’on pense aux danses de demain, quel héritage va-t-on transmettre aux nouvelles générations ? Les danses de demain sont façonnées par les choix qu’on fait aujourd’hui. Et c’était la même chose auparavant : nous sommes façonné·es par des choix faits avant nous.
L.D. : Dans ce spectacle, vous avez fait appel à Essia Daïbi. Comment l’avez-vous rencontrée et choisie ?
M.T. : Essia Daïbi est elle-même une artiste et metteuse en scène qui fabrique ses propres spectacles. J’ai vu son travail une première fois il y a trois ans, au festival Dream City, à Tunis. J’ai trouvé son approche artistique très inspirante esthétiquement et en même temps, c’est quelqu’un de très engagé, politiquement et socialement, qui met en scène des questions très importantes. Je pense qu’elle est la première personne à avoir travaillé avec la communauté LGBTQI+ à Tunis. Par ailleurs, nous sommes de la même génération et nous partageons des questionnements par rapport à la forme, par rapport aux questions d’histoire, de transmission, d’un point de vue décolonial, mais aussi dans un monde influencé par la globalisation.
L.D. : Pourquoi avoir choisi de mettre du texte et comment avez-vous appréhendé ce travail ?
M.T. : J’ai un rapport très particulier avec le texte. Il y a du texte dans tous mes projets et je pense que ça vient d’abord de quelque chose de très personnel. Quand je suis arrivé en Belgique, à l’école P.A.R.T.S., la formation était en anglais, et je ne parlais pas cette langue. Les deux premières années, j’ai suivi les cours sans vraiment comprendre les informations et j’ai très peu assisté aux cours théoriques. Avec mon premier projet, The Upside Down Man, j’ai senti la nécessité de passer par du texte. Je pense que mon corps, ou mon être, avait besoin d’exprimer des choses par les mots. On dit souvent que le corps dit plus que les mots, mais moi je dis également que le corps intervient quand les mots cessent, et que les mots reprennent quand le corps n’a plus rien à dire.
Par ailleurs, il y a aussi un point de vue plus politique : qui écrit l’Histoire ? Qui a le droit de la raconter ? Comment on la raconte ? On voit bien dans notre société l’importance de nommer les choses, parce que c’est comme ça qu’elles commencent à exister. Par exemple aujourd’hui, quand on voit ce qui se passe en Palestine, au Congo, en Ukraine, s’il y a un peuple qui est en train de se faire massacrer, c’est important de dire que c’est un génocide, que c’est de la colonisation. Donc de ce point de vue, pour moi, les mots sont importants. Ils peuvent cependant être en même temps une bénédiction et une malédiction. Il y a l’envie de dire et l’envie de laisser les choses émerger. Mais cet espace de contradiction et de complexité m’inspire beaucoup parce que je pense qu’on est tout le temps là-dedans. Nos relations seraient plus faciles, si on commençait par admettre la complexité plutôt que d’essayer de simplifier les choses, de les mettre dans des cadres. Il y aurait plus d’espaces d’empathie, de tentatives de compréhension. Et donc moi, je m’empare de ces tensions et je les mets sur scène, quitte à parfois me contredire moi- même. Entre ce que je dis et ce que je fais, il y a beaucoup de contradictions et cet espace m’intéresse.
L.D. : De la même manière que vous ne compreniez pas l’anglais, les spectateurices francophones ne comprennent pas tout car il y a des passages en arabe non traduit dans la pièce. Quel sens cela a-t-il pour vous et quelle place avez-vous voulu donner aux langues ?
M.T. : Cette idée est venue de nos échanges avec Essia. Tous ses spectacles sont écrits en dialecte tunisien ; c’est la langue qu’elle utilise. Et la première chose qu’elle m’a demandée est : pour qui fais-tu ce spectacle ? C’est intéressant parce qu’elle parle en tant qu’artiste tunisienne qui a fait ses études en France, à Paris, à la Sorbonne, avant de décider de retourner à Tunis pour parler au monde à partir de cet endroit-là. Et donc je trouve très intéressante sa question. À partir de là, on s’est dit qu’on allait travailler avec la traduction pas seulement comme un outil de « transparence » mais comme une ligne dramaturgique. C’est pour cela que dès le début du spectacle, il est dit qu’il n’y aura pas de traduction. C’est une invitation à écouter différemment. Et bien sûr, c’est encore politique, parce qu’il existe certaines langues dont on n’attend pas la traduction, comme l’anglais ou le français, car ce sont des langues qui dominent. C’est la même chose avec certaines danses, comme la danse classique. Là, pendant une heure, le public est invité à être perdu et à accepter de ne pas tout comprendre, mais aussi à approcher la langue comme une sonorité, une matière.
L.D. : Dans ce spectacle, il y a aussi un travail sur le costume et sur le masque...
M.T. : Dans le spectacle, il y a beaucoup d’éléments et d’inspirations sonores et visuelles qui viennent de la culture
hip hop. Les costumes ont eux aussi été développés à partir de cette iconographie, en collaboration avec la costumière et créatrice de mode belge Magali Grégoir. Le sweat-shirt est très « connu » socialement, et appartient aussi complètement à la culture hip hop – on a pensé à des artistes comme Kendrick Lamar ou Kanye West... Il y avait aussi l’idée de travailler le costume dans le sens de l’anonymat. Le costume ce sont des couches qu’on rajoute, une manière de cacher ou de montrer notre identité. Lorsqu’on est anonyme, il y a d’autres parties de nous qui se manifestent, il y a une espèce de liberté et un état de corps qui est complètement différent de quand on est visible. Dans la pièce, il y a ainsi un contraste qui s’installe entre la première partie qui est très codifiée au niveau gestuel, avec des langages de danse très posés dans l’espace —les traits de breakdance, de post-modern danse, de ballet— et la deuxième partie qui est comme une entrée dans l’espace spirituel de la culture hip hop, dans sa philosophie, avec une espèce de transe qui peut venir et une liberté qui se déploie. Ce contraste passe aussi par cette transformation physique à travers le costume.
L.D. : Comment articulez-vous votre parcours de chorégraphe à celui de danseur ?
M.T. : Bien sûr, ce sont deux fonctions différentes, mais pour moi il y a vraiment une continuité de mon travail d’interprète, dont j’amplifie certains motifs. Parce qu’aujourd’hui, en tant qu’interprète, on n’est pas seulement quelqu’un qui exécute, on participe aux pièces à beaucoup de niveaux, intellectuellement, dans l’écriture chorégraphique. On demande aux danseurs d’amener leur propre langage. Les artistes avec lesquels je travaille, la Needcompany, Sidi Larbi Cherkaoui, sont en dialogue avec leurs interprètes et donc, il y a une collaboration. Je me laisse traverser, comme là avec Larbi, avec lequel on est en tournée pour Ihsane, avec le ballet du Grand Théâtre de Genève. C’est intéressant d’être dans ce cadre-là en tant qu’interprète et bien sûr ça nourrit ma trajectoire personnelle.
L.D. : Pourquoi avez-vous choisi un titre aussi long ?
M.T. : C’était un choix bien sûr par rapport à sa signification, mais inconsciemment, je crois que j’ai trouvé cela intéressant parce qu’en fait, même moi, les premiers mois, quand je parlais à des professionnels, je n’arrivais pas à le prononcer. Je pense que c’est une manière de réagir à notre époque où on fait toujours court. Ce titre, personne ne s’en souvient tout à fait, tout le monde se l’approprie à sa façon, et c’est magnifique !