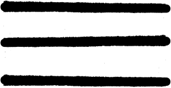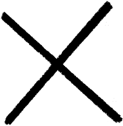Victor Roussel : Entre le geste artistique et la philosophie politique, comment travaillez-vous avec votre dramaturge Camille Louis ?
Léa Drouet : Il faut imaginer deux esprits un peu arborescents qui discutent pendant des heures. Nous croisons nos vies intimes, nos lectures, les évènements qui nous interpellent…. Nous prenons très au sérieux ces conversations désordonnées car elles font émerger des premiers échos. Puis, en apportant beaucoup de structure à notre processus de création, Camille me permet de rester à l’endroit de l’intuition, car elle est convaincue que la pensée artistique a une valeur en soi, qu’elle n’a pas besoin de se transformer en discours politique ou académique. Elle rappelle souvent l’importance qu’a et que doit avoir pour nous, travailleureuses du sensible, ce mode de pensée qu’est l’intuition et qui signifie « pensée par choc ». On a trop souvent tendance, dans notre société malade de son pseudo « réalisme politique », à considérer que « l’intuitif » rime avec l’émotif, le non rationnel… c’est faux. L’intuition c’est une forme de rationalité, de « logique de la sensation » dont précisément nous avons besoin pour élargir notre expérience du monde et ne pas céder à l’assèchement des affects qu’impose « le tout informatif ».
V.R. : Votre spectacle convoque sur scène l’histoire de votre grand-mère, échappant à la rafle du Vél’ d’Hiv’, puis celle de Mawda, une enfant kurde de deux ans abattue par un policier belge en 2018. Comment se sont inventés les échos entre ces deux histoires ?
L.D. : Des systèmes d’échos ont émergé en faisant cohabiter ces différents récits sur scène et, même si j’en avais l’intuition avant les répétitions, ces résonances sont d’abord apparues à travers mon corps. Par exemple, lorsque j’ai commencé à jouer la reconstitution du meurtre de Mawda, m’est venu le simple geste de porter son enfant, et ce geste s’est ensuite inscrit dans la première scène du spectacle, lorsque je parle de ma fille. De tels gestes sont comme des motifs qui se superposent à la narration et qui racontent différentes versions de ces histoires. Mais les échos se sont aussi trouvés grâce à la création musicale de Èlg, avec le retour de boucles sonores, de petits scintillements, qui donnent la sensation que les histoires se répondent. Je suis ensuite revenue à l’écriture, et j’ai cherché à prolonger ces résonances dans la matière textuelle. Ce fut le cas avec la figure du passeur par exemple : répondant à mes questions sur l’homme qui l‘avait aidée à fuir, ma grand-mère m’a répondu qu’il n’avait pas de caractéristique particulière. Cet homme « sans caractéristique particulière » s’est retrouvé dans le récit de Mawda et, plutôt que confondre notre époque avec celle de la Seconde Guerre mondiale, nous avons préféré, avec Camille, produire une vrille dans la représentation, une torsion. En 1942, tous les passeurs n’étaient pas des justes, certains en profitaient pour extorquer de l’argent, pour violenter les femmes. Et aujourd’hui, on imagine des passeurs forcément liés au grand banditisme mais certains font preuve de solidarité à l’égard des personnes qui traversent les frontières.
V.R. : Justement, comment rapprocher ces récits sans les enfermer dans un même discours ?
L.D. : Si je rapproche ces histoires, ce n’est pas pour les mettre en équivalence mais plutôt en résonance. On veille beaucoup avec Camille à laisser de la place aux spectateurices, qu’iels puissent faire les liaisons seul·es.
Car c’est aussi cela l’important : créer et offrir une expérience d’attention problématique et politique à celles et ceux qui viennent voir la pièce. Les époques, les situations que nous rapprochons sont différentes. Je ne veux pas que le spectacle ferme le sens et soit une démonstration. Le geste, la parole, la musique, tissent des lignes, prennent en charge la narration, mais sans jamais se superposer en s’unifiant, car la représentation serait alors trop signifiante, trop didactique. Dans l’écriture, je fonctionne donc beaucoup par soustraction, par excavation. C’est assez instinctif pour moi, je repère très vite quand le spectacle se met à donner des petites leçons.
V.R. : Comment vous décririez votre endroit de présence sur scène ?
L.D. : Je dirais que je cherche un endroit de léger retrait, comme un pas en arrière, dans le sens où j’essaye de me tenir derrière les faits que je raconte, derrière les histoires de Mawda et de ma grand-mère, tout en préservant une adresse chaleureuse et douce. En tant qu’interprète, c’est un équilibre parfois difficile à tenir car je peux vite donner l’impression d’une certaine froideur. Mais cette retenue est une façon de ne pas mettre mes émotions en avant de la représentation, de ne pas dicter aux spectateurices ce qu’iels doivent ressentir. Alors je reste à la lisière de ma colère et de mes larmes.
V.R. : Rester au bord des images, de l’incarnation, du discours, c’est donc une posture à la fois esthétique et éthique ?
L.D. : Oui, tout à fait. D’ailleurs, il m’est parfois reproché de ne pas y aller assez, de ne pas m’engager suffisamment dans le corps, dans mon émotion. Mais c’est un vrai choix de ma part : je ne veux pas avoir autorité sur le public et encore moins prendre la place de ses affects. D’où le travail de retrait dont je parlais plus haut et qui est un véritable artisanat dramaturgique que nous partageons avec Camille.
V.R. : Un sentiment de révolte peut-il grandir en nous à partir de cette douceur ?
L.D. : En procédant avec douceur, sans éclat, j’espère en effet qu’une colère plus active puisse émerger, une colère qui soit un levier d’action. J’ai découvert récemment l’étymologie du mot « agressivité » : aggredior signifie « aller vers », « se mettre en mouvement ». C’est pour ça qu’il ne faut pas réprimer l’agressivité des enfants, qu’il faut essayer de diriger cette énergie vers l’action. Sinon elle se retourne contre nous. Au contraire, la douceur, la bienveillance, ne doivent pas servir à étouffer la colère ou à refouler les affects tristes et violents. Dans la politique, comme dans les spectacles, il faut garder des espaces où ces affects circulent, où on les saisit collectivement.
V.R. : Le travail sonore sur votre voix, et plus largement la dramaturgie musicale du spectacle, répondent à ces mêmes intentions ?
L.D. : La musique de Violences est écrite par Èlg, qui compose également sa propre musique, et signe des bandes-sons pour des films. Il a un très grand sens de l’écoute et il est capable de traduire mes intentions en propositions très personnelles, avec un même goût pour faire frotter des matières, comme si la violence pouvait cohabiter avec l’extrême délicatesse. Dans Violences, il y a quelque chose du conte, des livres musicaux pour enfants. La musique et le son accompagnent avec douceur les affects qu’on traverse. Pour la partie du spectacle où je reconstitue la scène de la poursuite entre la police et la camionnette où se cachent Mawda et sa famille, nous avons cherché à toucher un type d’affect très particulier, celui de la dissociation, lorsqu’un évènement d‘une extrême violence provoque un état cotonneux. On s’est notamment inspiré de vidéos où des policiers démantèlent des camps de réfugiés et où tout se fait sans heurt, doucement, dans un état de sidération…
V.R. : Au-delà de la sidération, comment se saisir des histoires de Mado et de Mawda sans reproduire la violence ?
L.D. : Avec Camille, nous avons récemment participé à un séminaire sur Fernand Deligny, un psychiatre et éducateur qui a accompagné des enfants autistes, et sur Jacques Lin, qui l’accompagnait et a écrit le récit Une vie de radeau. Je me reconnais complètement dans son projet d’écriture : il ne fait que décrire ce qu’il voit, le plus concrètement possible, sans porter sur les enfants un regard analytique et surplombant, sans chercher le diagnostic. Ce qui, bien sûr, ne signifie pas une neutralité, car il y a toujours un regard, une perspective. Cette posture m’a vraiment permis de m’approcher des histoires de Mado et Mawda sans leur surimposer l’impact émotionnel ou moral qu’elles ont sur moi. Je m’en tiens au factuel et à l’écoute. Quand j’ai interrogé ma grand-mère, je lui ai également demandé de me raconter les faits, ce qu’elle entendait ce qu’elle voyait, les évènements, les gestes, sans mentionner l’état émotionnel dans lequel elle se trouvait. Les langues qui me touchent cherchent aussi cette poétique du simple, Jon Fosse par exemple, ou Les oiseaux de Tarjei Vesaas. En fait, je crois que les métaphores m’inquiètent un peu, j’ai peur qu’elles produisent de l’euphémisme ; qu’elles détournent le regard.
V.R. : La scénographie, pourtant, dessine un paysage métaphorique…
L.D. : Je manipule la scénographie d’une façon très premier degré ! C’est une maquette : quand je saisis une petite maison, elle ne figure pas autre chose que le commissariat dont je suis en train de parler. Enfin… ce n’est peut-être pas tout à fait vrai. Il y a quand même l’image du bac à sable, des enfants qui reconstituent avec leurs jouets les scènes de leurs vies pour mettre à distance la violence et les belles choses qui leur sont arrivées. J’ai l’impression que je fais la même chose au théâtre : je crée au plateau une situation où je peux élaborer – et non pas métaphoriser – la violence que j’ai pu ressentir en découvrant l’histoire de Mawda.
V.R. : Est-ce qu’écrire autour de l’enfance vous permet de construire un rapport singulier au politique ?
L.D. : C’est devenu de plus en plus conscient, notamment grâce au regard de Camille qui a aussi écrit La conspiration des enfants. Je crois qu’on vit toustes des évènements très forts dans l’enfance, qu’on ressent le monde avec une grande intensité émotionnelle. Mais les adultes, souvent, délégitiment et altérisent ce moment de l’existence, comme s’il y avait une rupture franche, comme s’il ne subsistait rien de l’enfance en nous. On met l’enfance à distance, on l’objectifie, on crée une figure de l’enfant idéal pour mieux l’écarter de la scène politique. On lui parle en prenant une « petite voix », et d’ailleurs on prend la même voix pour parler aux étrangers ou aux personnes âgées et ainsi leur nier toute puissance d’agir. Travailler sur scène autour de l’enfance, ce n’est donc pas convoquer son innocence mais bien cette façon parfois inquiète qu’ont les enfants d’élaborer leur propre représentation du monde et leur place dans la société.
V.R. : D’un spectacle à l’autre, votre approche du plateau, et notamment votre manipulation de la scénographie, donne à voir un travail d’agencement et de réagencement des espaces, des institutions. Dans Violences, la justice, la police…
L.D. : Lorsque j’ai joué mon spectacle Boundary games au Théâtre Nanterre-Amandiers, Marie-José Mondzain avait posé des mots très justes sur ce que j’avais essayé de faire, ce qui m’avait d’ailleurs beaucoup émue. Elle avait parlé du travail de composition et de recomposition des images, d’agencement d’espaces qui ne cessent de se métamorphoser. Ça traduit peut-être mon rapport paradoxal à l’institution. D’un côté, il est utile et nécessaire que l’institution organise la société en produisant des statuts permettant à des personnes d’accéder à des aides, à des droits, à du soutien. Mais, d’un autre côté, j’ai toujours un peu peur que ces statuts finissent par imposer des identités trop figées, trop étriquées. L’institution, comme le dit Merleau-Ponty que cite souvent Camille sur ce point, c’est ce qui permet à l’expérience de durer, à condition toutefois que ce cadre reste en mouvement et se questionne. Le théâtre permet cela : faire l’expérience collective d’un cadre qui repose sur de fortes conventions esthétiques, inscrites dans une institution culturelle, mais au sein duquel on essaye de faire évoluer nos représentations du monde.
Merci à Camille Louis pour sa relecture.