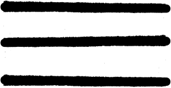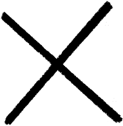Laure Dautzenberg : Comment est née l’envie de faire ce spectacle ?
Joaquim Fossi : J’ai commencé à penser à ce projet un jour où j’étais seul chez moi en plein été et qu’il y
avait une quantité d’images assez hallucinantes qui se conjuguaient. Il y avait les images d’incendies en
Europe, celles des émeutes qui ont suivi la mort de Nahel à Nanterre, et celles du 14 juillet avec ses feux
d’artifice. J’avais vraiment le sentiment que ces images-là avaient remplacé ma vie réelle et qu’elles me
racontaient quelque chose de la fin du monde. Cela m’a mis dans une grande angoisse. J’ai lu au même
moment Vers un réalisme global de Milo Rau. Il y écrivait qu’il regardait des images de soldats qui vont
se faire tuer avec un mélange de plaisir, de peur et de triomphe. Et je me suis dit que c’était comme trois
premiers indices. Je suis parti de là. En travaillant, je me suis rendu compte que ce n’était pas la fin du
monde en soi qui me travaillait mais le sentiment de fin du monde, le sentiment d’effondrement qui est
propre à ma génération. En m’intéressant à la question, j’ai constaté cependant que cette thématique avait
toujours été présente : la littérature eschatologique, la littérature de l’apocalypse, les récits de déluge
abondent dans les trois religions monothéistes ; la page Wikipédia des prédictions de fin du monde montre
qu’il y a presque une prédiction tous les dix ans depuis l’an 0. Je me suis donc demandé ce que cela
voulait dire d’être tendu vers cette idée en permanence et s’il y avait malgré tout quelque chose d’inhérent
à notre époque. J’en suis arrivé à l’hypothèse que ce qui caractérise le monde contemporain, c’est le
sentiment d’une mutation extrêmement rapide, provoqué essentiellement par la prolifération des images,
notamment celles de catastrophes. Dans le fond, le bouleversement psychique qui s’est opéré entre le
Moyen Âge et aujourd’hui, c’est cela : on connaît désormais le monde par les images plus que par nos
yeux. L’assassinat de Nahel Merzouk autant que les feux de forêt en Californie créent un sentiment de
proximité immédiate de l’effondrement. Je me suis alors dit que ça allait être un spectacle sur les images.
Car il y a maintenant une espèce de fuite liée à leur prolifération ; il y a trop d’images pour les yeux que
nous sommes. Un calcul dit qu’il existe aujourd’hui 21 000 milliards d’images - 1 000 milliards jusqu’à
l’année 2000, et 20 000 milliards depuis l’avènement d’internet et des téléphones portables ! Il y a donc
une courbe exponentielle hallucinante, vertigineuse, qui relève de ce qu’on appelle en histoire la grande
accélération. Je suis né en 1998, précisément au moment de cette grande accélération. Si j’étais né au
Moyen Âge, j’aurais consommé une image par an jusqu’à la fin de ma vie. Aujourd’hui, j’en consomme
1000 par jour. Ces vertiges-là m’ont fait dire que nous étions en train de créer un continent dans lequel on
allait se noyer. C’est donc un spectacle sur le stress que les images procurent, mais aussi sur l’énigme de
l’excitation que certain·es y trouvent.
L.D. : Comment amener ces réflexions sur un plateau ?
J.F. : Au début, je commençais le spectacle en disant que j’allais entrer en guerre contre les images. Mais
je me suis rendu compte que j’étais un pur produit des images, et je pense que c’est le cas de toute ma
génération. Je suis né en même temps qu’internet et internet me constitue et coule dans mes veines. Je fais
du dessin, de la photo... Je pense qu’elles sont tellement tissées et imbriquées dans le réel aujourd’hui que
si on voulait faire survivre des parts de nous, il faudrait faire survivre ces images. Alors l’idée a plutôt été
de les valoriser, de les réutiliser, d’avoir en quelque sorte un rapport écoresponsable avec elles ! Moi
j’adore le Louvre, par exemple, parce qu’on peut s’arrêter devant les peintures. Je ramène donc cet
immense sujet à une forme extrêmement simple. Je vais devant le public, et je présente la situation : nous
sommes en 7506, et j’appartiens à un labo archéologique qui travaille sur ce qu’a pu être internet. Je suis
donc un archéologue du futur qui expose les résultats de fouilles en 10 tableaux. L’idée est d’interroger,
d’imaginer, de manière ludique ce qui restera, comment les images continueront à exister après que nous
aurons déguerpi, et d’avoir une réflexion sur ce qui se passe entre elles et nous. Je le fait à partir d’un
ordinateur et d’un vidéo projecteur, avec ces outils techniques que nous utilisons tous et toutes
aujourd’hui et que je trouve amusant de convoquer ici.
L.D. : Vous semblez sensible à l’idée de rangement : vous avez travaillé sur les cartes, qui sont une
façon d’organiser l’espace, Short Message Service est construit par chapitres sur les histoires
amoureuses, dans votre projet autour du Louvre vous sélectionnez 46 œuvres... Ici vous faites une
recension archéologique, ce qui est encore une manière de ranger. Quel est votre rapport à cela ? Et en
quoi cela peut faire théâtre pour vous ?
J.F. : J’ai mis récemment un mot sur tout ce que je faisais : ce sont des « gestes anxieux ». Les gens
anxieux comme moi cherchent de l’ordre dans le chaos et dans le simple fait d’ordonner. Les œuvres
principales de mon panthéon sont des œuvres de rangement : Espèce d’espace de Georges Perec,
Autoportrait d’Édouard Levé, et Notes de chevet de Sei Shonagon qui a été dame de cour au Japon, au
XIe siècle, et qui établissait des listes de choses : les choses qui font battre le cœur, les choses désolantes,
les choses dont on néglige souvent la fin... Elle a ordonné le monde avec des listes et cela me bouleverse.
Tout comme me touche l’esprit encyclopédique des Lumières. L’universalisme est très décrié aujourd’hui
et il faut évidemment le requestionner au prisme de la remise en question de l’Occident, mais j’aime le
geste encyclopédique des Lumières qui croit à un possible commun pour l’intégralité de l’humanité.
Ensuite pourquoi ça fait théâtre, pourquoi le mettre en jeu ? Il y a quelque chose auquel je suis très
sensible, c’est le principe de communauté. Je n’oublie jamais le public, je joue beaucoup avec lui ; même
si je mets sur scène le délire d’un jeune homme anxieux, je m’efforce de faire entrer le public dans mon
cerveau. Je pense qu’il y a un enjeu à regarder ces images-là ensemble, à profiter de la communauté que
nous formons pour réaliser que ces images, ce sont des choses que l’on a en commun.
L.D. : Comment choisir parmi toutes ces images ?
J.F. : Après avoir beaucoup réfléchi, je me suis dit qu’il fallait que j’assume l’absolue subjectivité de mes
choix. Je peux tenter de toutes les manières possibles et inimaginables de le justifier mais c’est au fond
injustifiable. On peut m’attaquer sur mes choix comme on peut attaquer le responsable des acquisitions du
Louvre ! J’ai pris le parti de dire « c’est mon musée ». Mais j’avance des hypothèses devant le public, vis-
à-vis d’images qu’il connaît très bien. C’est le fond d’écran Windows, le smiley, la météo, le coucher de
soleil, ce sont des images qu’on a tous et toutes vues.
L.D. : Vous avez la volonté d’être ludique. Pourquoi cette envie ?
J.F. : Les œuvres qui me touchent font appel à quelque chose du jeu, de l’enfance, de l’échange aussi.
Pour moi, le ludisme c’est mettre le spectateur, la spectatrice dans la même situation que moi, de
provoquer des situations vis-à-vis de ce qu’il ou elle voit. Ici, comme je travaille avec les images, il est
beaucoup question de montrer / cacher, laisser deviner, décrire sans montrer, montrer sans décrire,
montrer et décrire quelque chose d’autre et créer comme ça des rapports de tensions. Je trouve que cela
garde le spectateur, la spectatrice actif·ve et je trouve cela important. Et puis dans ce spectacle-là, l’enjeu
est de repeupler l’imaginaire, de recréer du jeu entre le regard et les images, pour regagner la distance qui
permet de reprendre sa respiration, de mettre ces images un peu plus loin et d’être capable de s’en
réemparer.
L.D. : Le porno, ses images, ont une importance prépondérante dans le spectacle. Pourquoi leur avoir
donné cette place ?
J.F. : Le porno a pris de fait une très grande place dans ma recherche. Comme jeune homme de 28 ans
grandi en Occident au début du XXIe siècle, la pornographie a structuré mon regard : j’ai eu accès à des
millions d’images de ce genre, gratuites, en permanence. C’est une masse énorme du trafic mondial sur
internet. Et cela fait partie des images qui changent la vie, qui changent tout, qui formatent le regard,
influencent notre façon de regarder les corps, d’aimer... Comme mon projet s’articule autour de la
question de « qu’est-ce que les images font aux humains, aux corps, aux cerveaux », je ne pouvais pas ne
pas les évoquer. Je me suis plongé dans le sujet, j’ai suivi les travaux du Sénat, les procès qui émergent.
Mais il y a tellement peu de temps que c’est un sujet que le mal est déjà fait. Sans parler du fait que les
mesures peuvent apparaître comme dérisoires comparées à la capacité des enfants et des adolescents à
détourner les règles numériques. J’ai choisi dans le spectacle d’avoir un regard naïf, face à ces images
comme aux autres que je convoque, un regard souvent enthousiaste et troublant par son enthousiasme qui
peut paraître totalement à côté de la plaque et dans l’erreur. Face à ces images en particulier, ce regard
peut paraître amoral, dérangeant et grinçant mais j’espère faire sentir au public l’horreur qui peut être
induite dans ces vidéos en décalant le regard et en les observant simplement comme des objets picturaux.
Car cela m’intéressait aussi de les regarder autrement, des les utiliser à un autre escient. Pendant mes
recherches, j’avais à un moment enlevé les corps pour ne laisser que les décors et je trouvais cela
intéressant. Et j’ai voulu « coupler » cette question à la question amoureuse parce que je pense que
beaucoup de jeunes aujourd’hui pensent que l’amour c’est ça. J’ai ainsi créé « titifucker » qui se demande
à quel moment d’une séquence porno précise les acteurices sont tombé·es amoureux·ses. La réponse est «
je tombe amoureux à chaque fois ». Autrement dit c’est une fabrication. Et son regard face caméra dit bien
: « je ne suis pas dupe de ce que je suis en train de fabriquer. Je suis en train de fabriquer quelque chose
que tu dois croire... » C’est ça qui m ‘intéresse et il est certain que j’aimerais un jour travailler avec un
acteur porno, car si l’industrie du porno est celle qui est la plus désastreuse, évidente et terrible en terme
d’identité, elle accentue quelque chose à l’œuvre ailleurs, dans la fabrique d’images en général, dans les
fictions et les séries, dans des modes de représentations de l’amour qui comporte aussi leurs formes
d’oppression.
L.D. : Vous travaillez sur ce spectacle avec Noham Selcer et Nine d’Urso, vous travaillez par ailleurs
avec Suzanne de Baecque et Maxime Crescini, tous et toutes rencontré·es à l’École du Nord. Quelle
place a eu cette formation ?
J.F. : J’y suis entré à 19 ans et cela a été une expérience fondamentale. Nous avons été 14 acteurs et
actrices en vase clos pendant trois ans. À la fin ce ne sont plus des ami·es, des collaborateurices, c’est une
espèce de famille supplémentaire. Ensemble nous avons rencontré Guillaume Vincent, Alain Françon,
Marie-Christine Soma, Christophe Rauck, Cécile Garcia Fogel, mais aussi Tiphaine Raffier et Julien
Gosselin, sorti·es également de l’école du Nord, nous avons suivi trois saisons dans le regard d’un
programmateur-producteur. Cela a confirmé mon énorme goût pour le texte, m’a donné quelque chose que
j’appellerais l’esprit du Nord, et m’a fait traverser une expérience fondamentale qui est celle des croquis
de voyage. Nous devions partir un mois sans téléphone en France et revenir avec une forme. Au retour de
mon expédition, j’avais un texte, j’étais assis sur le rebord d’une fenêtre. Il n’y avait rien. Et je me suis dit
si un jour je fais des spectacles, ce sera à peu près ce dispositif-là.