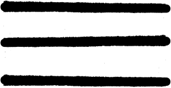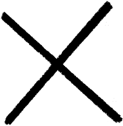On retrouve souvent dans votre travail la reconstruction d’un parcours, d’une enquête. Comment cela s’est-il passé pour Affaires Familiales ?
Pour cette pièce, je voulais saisir l’espace où la parole se formule entre l’intime et le juridique, le chemin où se croisent le récit personnel et la loi. Je voulais aussi interroger la friction entre droit et militantisme. J’ai rencontré des avocat·es spécialisé·es et des justiciables dans différents pays d’Europe. Divorce, filiation, violences, héritage : chacun et chacune vient avec sa manière de faire ou de défaire la famille. Mon geste commence par la rencontre, l’écoute, la récolte. Dans ce parcours mes attentes se frottent au réel et se déplacent. Je laisse émerger ce qui résonne avec mes préoccupations, ma sensibilité et ce que le dispositif théâtral peut accueillir.
Vous évoquez la friction entre droit et militantisme. Qu’est-ce qui vous intéressait ?
Je voulais montrer que la justice ne fonctionne pas en vase clos, que le droit n’est pas figé, et qu’il ne se transforme pas tout seul. La justice ne fait pas que juger au nom de la loi, elle participe à façonner la société. Elle dit ce qui compte, ce qui est acceptable, ce qui est reconnu. Elle produit du réel. Quand la société évolue et que la justice ne suit pas, elle doit être questionnée, poussée, déplacée. Pour Affaires Familiales, j’ai voulu faire entendre des personnes qui font bouger les lignes de l’intérieur.
Qu’est-ce que cette juridiction des affaires familiales raconte de notre société ?
Dans les affaires familiales, les enjeux politiques sont pris dans des parcours de vie concrets. Les violences intrafamiliales, les droits des familles LGBT+, les luttes pour l’égalité femme-homme, ont des noms et des visages. Les archives judiciaires sont une somme de récits de vie d’anonymes qui font Histoire. On hérite d’une vision très traditionnelle de la famille qui reste le vecteur de rapport de domination, entre adultes et enfants, entre hommes et femmes… Les politiques réactionnaires s’accrochent à une vision traditionnelle, mais cet ordre bouge. Parfois la justice suit, parfois elle précède, parfois elle résiste.
Vous vous mettez en jeu plus que d’habitude puisque vos questions sont au plateau... Pourquoi ?
Oui, les questions sur scène sont les miennes : je suis une femme, lesbienne, j’ai grandi avant MeToo, j’ai été confrontée à la justice. Pour l’écriture de ce personnage, je voulais assumer ma subjectivité, l’incarner, mais je ne voulais pas faire une pièce témoignage. Il fallait trouver un équilibre dans le texte et au plateau. Au final, tous les acteurices de la distribution m’interprètent et se transmettent le rôle comme un bâton de relais. Ce personnage est une figure d’écoute, il est dans une quête de compréhension, il est le moteur de la pièce.
Vous avez construit votre pièce en 9 « tableaux ». Comment cette construction est-elle venue ?
Parmi toutes les rencontres enregistrées, nous avons choisi d’en rejouer neuf. Nommer ce choix, c’est aussi laisser apparaître un hors-champ. J’aime les dramaturgies fragmentaires, où le·la spectateurice tisse ses propres liens avec ce qu’iels voient, savent, imaginent. Le rush de chaque entretien est initialement beaucoup plus long, en moyenne deux heures. Le montage consiste à opérer des choix, à se centrer sur un sujet, tout en conservant le mouvement de pensée, les respirations, les accidents. La dramaturgie s’est inventée à plusieurs mains avec Sarah Maeght, co-autrice de la pièce. L’écriture, c’est aussi l’agencement des séquences : décider d’un raccord thématique ou d’un décalage, organiser des échos ou des ruptures. Pendant les entretiens, je pense déjà au montage : je me dis “tiens, ça résonne avec ça, ça peut s’enchaîner, se contredire”… Cela modifie mes questions et la pièce se compose aussi sur l’instant. Le jour où Lilia Mhissen m’a annoncé sa victoire à la Cour européenne des droits de l’homme*, j’ai su que ce serait la scène de fin de ma pièce. J’étais heureuse pour la cause, et pour ma dramaturgie. Double victoire !
Est-ce un hasard si vous avez interrogé principalement des avocates ? Comment formez-vous votre corpus ?
Au départ ce n’est pas un choix, mais une réalité de terrain. Les affaires familiales ne sont pas les plus prestigieuses ni les plus lucratives, ce sont souvent des femmes qui se spécialisent sur ces dossiers. Quand j’ai vu ce déséquilibre dans le corpus, je n’ai pas cherché à le corriger. Constituer une sélection d’archives est toujours un geste subjectif, les possibilités sont infinies. Ici c’est aussi un geste de création, je garde les paroles qui résonnent en moi, j’ai choisi des personnes qui portent des engagements forts. Et puis ce qui m’importe ensuite sur scène, ce n’est pas de reproduire fidèlement une identité, mais de faire circuler une parole, une énergie, une position.
Comment se passe la transmission de cette expérience documentaire au reste de l’équipe ?
C’est une pièce que nous portons depuis plusieurs années, avec des allers-retours entre le plateau, la recherche documentaire et l’écriture. Nous regardons collectivement les rushs des rencontres, certaines parties sont jouées dans leur intégralité, avant d’être montées. Cela permet d’éprouver d’abord la théâtralité de la parole, ses images, son rythme, ses vides, et ensuite de se concentrer sur des choix de sens. Le projet final n’est pas de transmettre des informations mais de créer l’instant où on pense ensemble. En répétition, nous travaillons sur le mouvement de pensée, la parole pensante et la pensée parlante, sur ce qu’on entend dans ce qu’on ne dit pas, sur les plis du langage. On ne cherche pas à reproduire le contexte réaliste de l’interview, on décadre pour trouver une distance juste, active, sensible, avec l’archive initiale.
Vous avez voulu élargir votre propos à l’Europe. Qu’est-ce que cela vous a apporté ?
J’ai ouvert mes recherches à d’autres pays européens pour voir comment d’autres lois et d’autres politiques structurent nos histoires intimes. Aujourd’hui, une famille homoparentale en France n’a pas la même vie, ni les mêmes droits qu’une famille homoparentale en Italie. Une victime de violences intrafamiliales ne sera pas reçue de la même manière dans un commissariat à Paris ou à Lisbonne. Dans la pièce on fait aussi plusieurs références à la Cour européenne des droits de l’Homme1, cette instance qui, malgré les disparités nationales, peut statuer sur les injustices les plus profondes. Avec Affaires Familiales, j’invite le public à penser la famille non comme une affaire privée, mais comme un projet de société.
Les interprètes reprennent les entretiens dans la langue d’origine de l’interviewé. Pourquoi ce parti-pris ?
Le langage est au coeur de mon travail. On fabrique du sens ensemble, à travers les mots, les accents, les hésitations. Chaque langue porte un regard, une musique, une tension. Comme la pièce est une quête, je voulais aussi garder les zones de frottement : les bugs, les silences, les passages à franchir. C’est aussi un choix politique et sensible : refuser la simplification, l’immédiateté, pour faire exister un espace qui fait entendre les voix sans les aplatir.
Quel dispositif scénique a été conçu pour ce spectacle ?
Nadia Lauro, scénographe du spectacle, a conçu un espace bi-frontal, une page blanche, une topologie habitée par les interprètes, les récits, où sont aussi projetés des fragments de film. Son dispositif crée une géographie de regards : ceux des interprètes, des spectateurices, des images. Il place le public en vis-à-vis, sans protection du quatrième mur, comme dans une salle d’audience. Un même récit existe en plusieurs versions : celle de la personne filmée, celle portée par l’interprète, celle que crée le montage. Ce jeu de reflets, d’angles, de répétition, fait écho à la manière dont l’institution judiciaire, elle aussi, découpe, rejoue et reformule. Le plateau devient alors un espace de relais : des paroles, des silences, des regards, la musique originale de Carla Pallone, qui tisse une autre dimension sensible au récit.
La présence de la vidéo est particulière : nous voyons des bribes, des mains, plus rarement des visages. Saviez-vous d’emblée quelle place vous lui donneriez ? Comment avez-vous décidé de la travailler ?
Je voulais que la caméra soit un regard qui se balade, comme on le fait quand on écoute quelqu’un parler. La caméra tourne en continu, pour garder les mises au point, les flottements, les cadrages. J’ai travaillé alternativement avec deux cheffes opératrices, Joséphine Drouin Viallard et Alexandra de Saint Blanquat. Les scènes sont filmées à une seule caméra, il n’était pas question de recomposer le champ contrechamp du dialogue filmé. L’image devait être un contrepoint à la scène, une échappée, superposer une autre réalité. On a travaillé sur des fragments de décors, des mains, des bribes de mouvements. Le découpage, les plans serrés, contrastent avec le dispositif scénique qui se donne à voir en totalité. Quant aux visages des interviewés, je les montre avec parcimonie car je veux nommer les personnes réelles, ne rien effacer du processus, mais sans les incarner. Je confie l’incarnation à l’interprète sur scène. Chaque soir, on recrée ces rencontres, les pensées qui s’inventent, les émotions. C’est là que le théâtre commence.
Propos recueillis par Marion Guilloux et Laure Dautzenberg
.* En janvier 2025, La Cour Européenne des Droits de l’Homme a rendu une décision historique, condamnant la France pour avoir prononcé un divorce pour faute aux torts exclusifs d’une femme au motif qu’elle refusait des relations sexuelles avec son mari.