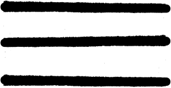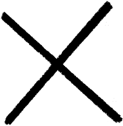Laure Dautzenberg : Comment est né Les corps incorruptibles ?
Aurélia Lüscher : J’ai eu envie de réaliser ce projet suite à la perte de ma grand-mère. Comme tout le monde, quand on perd quelqu’un de proche, on se rend compte qu’il y a des choses qu’on ne sait pas, comme où va le corps, qui s’en occupe, et mon père ne savait pas me répondre. J’ai donc fait un stage dans une entreprise de pompes funèbres pour savoir comment on s’était occupé d’elle et à qui on déléguait le droit de prendre soin de nos morts. Ce stage m’a révélé un monde, au point que j’ai envisagé d’en faire mon métier ! Je suis allée visiter une université à Bron où il y a une section thanatopraxie - embaumement. Puis j’ai été prise dans une école de théâtre, donc j’ai mis ça de côté. Je me suis dit que je m’occuperai des morts à un autre moment, sachant que je considère qu’il y a dans le théâtre comme dans la mort un rapport au sacré et à la cérémonie. Cette question m’a néanmoins poursuivie toutes ces années ; j’ai lu beaucoup de livres, rencontré beaucoup de gens, j’ai refait des stages avec des thanatopracteurs, rencontré des travailleurs et des travailleuses du funéraire, ainsi que des féministes, des penseureuses et chercheureuses dans ce domaine. Suite à toutes ces rencontres, à ces lectures, j’ai eu envie de restituer mon enquête : comment s’occupe-t-on de nos morts et qu’est-ce-que cela raconte aujourd’hui de notre société occidentale ?
L.D. : Il y a dans cette pièce, comme dans le travail avec le Collectif Marthe, dont vous faites partie, une volonté documentaire. Pourquoi ce désir-là ?
A.L. : J’ai besoin de passer par le document, l’enquête pour pouvoir écrire. Je suis comédienne et je n’ai pas une pratique d’écriture où je suis seule dans une chambre, concentrée devant mon ordinateur ou avec un calepin. J’ai vraiment besoin de traverser les choses physiquement, de rencontrer des personnes et d’expérimenter pour pouvoir restituer ensuite quelque chose. Au départ j’ai mené cette enquête sans l’idée d’en faire un spectacle – je m’intéresse à cette question depuis 2010. C’est venu au fil du temps et les choses ont mis très longtemps à se déposer pour que je trouve une forme appropriée. Mais quand je parle de ce spectacle, je dis que c’est une performance documentée et non du théâtre documentaire, car il y a quand même aussi une part de fiction, une part d’imaginaire, de poétique et de projection qui se mélange à la réalité et parce que les choses que je transporte et porte au plateau en font un spectacle éprouvant !
L.D. : C’est la première fois que vous convoquez autant votre travail plastique sur scène.
A.L. : C’est en effet un projet où je réunis la performance plastique et l’écriture théâtrale qui sont les deux manières que j’ai de rendre au monde des choses qui me traversent. Je pense que le projet se prêtait vraiment à cela parce qu’il y a quelque chose de très concret, de très physique dans la question des corps, des dépouilles mortelles, de notre rapport à la transformation et à la pourriture... Pourquoi ne veut-on pas qu’ils se transforment, pourquoi cache-t-on les modifications de la couleur de la peau ? Le côté plastique et visuel était très important pour rendre compte de cette matérialité-là. Pouvoir parler d’un corps et le matérialiser sous nos yeux, ce n’est pas la même chose que juste en parler.
L.D. : Dans cette pratique plastique vous utilisez la céramique. Pourquoi ce choix ?
A.L. : Je travaille avec l’argile parce que c’est un matériau incroyable qui se modèle à l’infini tant qu’il n’est pas cuit. La terre sèche, on la mouille et elle redevient semi-solide, modelable, comme un corps qui se transforme et change de matérialité. Le cadavre a un statut un peu particulier, ce n’est plus tout à fait une personne et ce n’est pas tout à fait un objet, que ce soit sur le plan légal, ou dans notre tête, symboliquement. Par ailleurs, pour moi, physiquement, le corps humain mort - et j’en ai touché beaucoup lors de mes stages - a quelque chose de froid, un peu humide qui ressemble vraiment à de l’argile. Enfin, il y a dans ce travail toute une réflexion sur le fait de retourner à la terre. Aujourd’hui, on est mis dans des cercueils, et souvent dans des caveaux. Les enterrements en pleine terre sont rares, même si je pense que c’est en train revenir. Or il y a pour moi un lien entre le déni de la mort et le déni de la terre, surtout dans la pensée occidentale, que ce soit au niveau de la philosophie ou au niveau de la religion. On nous a beaucoup dit que la terre était un exil, et que ce serait mieux après. Pouvoir travailler avec de l’argile me paraissait intéressant dans l’idée de remettre son corps à la terre.
L.D. : Il y a un croisement dans ce spectacle entre pensée de la mort et pensée de l’écologie.
A.L. : Oui. Le fait de prendre tout ce qu’on peut de la terre sans jamais rien donner, même pas son cadavre à manger à d’autres, raconte beaucoup de choses de la manière dont on conçoit le vivant. Une philosophe australienne, Val Plumwood, m’a beaucoup aidée à comprendre pourquoi est-ce qu’aujourd’hui on s’occupe de nos morts de cette manière. Cette philosophe, décédée maintenant, a décidé un jour d’aller visiter la faune et la flore dans le nord de l’Australie. Elle s’est fait attaquer par un crocodile et suite à cet événement, elle s’est dit « c’est incroyable, j’avais complètement oublié que je pouvais être de la nourriture ». Son livre, L’œil du crocodile, parle de cet événement et de la manière dont il a refondé entièrement sa pensée. Et ça m’a bouleversée. Je me suis dit que c’était exactement ça le problème qu’on avait avec la mort : on s’est extrait de la chaîne alimentaire ; on ne veut pas se faire manger. On dit retourner à la terre, mais en fait on n’a jamais envie de la toucher. Cette volonté de ne jamais se désagréger, de ne jamais se transformer, de ne jamais se faire manger par des insectes nécrophages ou par des champignons est très étonnante. Le titre fait ainsi référence au fait que l’Église catholique appelle corps saints, corps incorruptibles, les corps qui ne se transforment pas, qui ne pourrissent pas, qui ne sentent pas mauvais. J’ai entendu ce mot au sujet de Bernadette Soubirous et je me suis dit que ça reflétait vraiment bien notre société d’avoir des cimetières pleins de corps intacts parce qu’ils sont emballés pour ne pas être transformés par la terre, décomposés.
L.D. : Vous parlez du cadavre qui est entre-deux et vous dîtes avoir voulu faire un spectacle qui est justement dans un espace interstitiel, de porosité. Comment avez-vous mis en forme cet espace entre les choses et pourquoi teniez-vous à cette dimension-là ?
A.L. : Je tenais à la dimension de porosité, de passage d’un état à l’autre parce que, suite à mon enquête, je me suis dit que la mort est un processus. Les morts continuent de nous accompagner d’une manière ou d’une autre, ils continuent d’interagir avec nous. Je voulais que toutes les choses puissent glisser, que cela puisse être fluide, sans mettre de cadres qui soient entièrement définis ; je n’avais pas envie qu’il y ait de séparation. Nous avons ainsi essayé, avec les lumières, de passer d’une chose à l’autre sans que l’on s’en rende compte. Cette porosité-là est aussi dans la scénographie, dans laquelle je propose de passer d’un espace d’atelier d’artiste à une morgue, puis à une inhumation en pleine terre, dans un cimetière communal.
Je voulais également que cela soit fluide entre le public et le plateau. Le plateau est blanc, et le blanc a un grand pouvoir reflétant ; je vois donc tout le monde, tout le temps. Enfin je n’incarne pas un personnage. Tout passe par une forme de restitution ; je veux rendre les spectateurs et spectatrices actifs et actives d’une enquête que je retrace avec elleux. Parfois je leur pose des questions, je fais des blagues. Ce n’est pas un spectacle participatif, mais je pense que cette adresse participe aussi de cette porosité que j’essaie de mettre en exergue entre les morts et les vivants, entre le passé et le présent, et entre la vie réelle et la fiction.
L.D. : Vous convoquez l’intime au plateau notamment en sollicitant votre mère.
A.L. : Oui, l’idée de solliciter ma mère est venue assez vite dans le processus de création. À partir du moment où j’ai voulu en faire un spectacle, je me suis dit que la personne avec laquelle j’allais vraiment devoir parler de cela parce que je suis sa seule fille, c’est ma mère. J’ai donc commencé à l’interroger sur le sujet. Au bout d’un moment, j’ai commencé à enregistrer, sans savoir trop ce que j’en ferai. J’ai donc beaucoup de conversations qu’on a eues, de messages qu’elle m’a envoyés en disant « Là je suis dans la campagne, dans le Jura et en fait je suis dans une clairière. Et il s’est passé un truc incroyable. J’ai parlé avec mon père ! » Bon OK, très bien, qu’est ce que je fais de tout ça ? Le spectacle s’est construit avec ce double niveau : cette enquête dans le milieu funéraire et cette enquête intime.
L.D. : Vous évoquez la volonté de réenchanter la mort. Que voulez-vous dire par là ?
A.L. : « Réenchanter la mort », c’est le titre d’un article d’Alexa Hagerty qui m’a beaucoup marquée, sur des funérailles à domicile aux États-Unis(1). Elle dit que le fait de veiller quelqu’un·e, de veiller un corps, de se réunir autour d’une personne, peut nous apprendre des choses sur nous, sur la famille, que ce soit une famille de parenté ou une famille choisie, sur notre lien au défunt ou à la défunte. Or aujourd’hui on prend moins de temps pour s’occuper des mort·es, on dépense moins d’argent, on les prend moins en compte. Et du coup, on réfléchit moins à la mort, on ne l’investit pas de manière personnelle. On a 48h pour décider de ce qu’il faut faire, mais peut-être que ce qu’on nous propose ne nous convient pas. Si on prenait le temps de le penser avant, ou en tout cas d’aller vers des personnes qui nous poussent à penser ce moment, cela nous permettrait de faire des cérémonies qui soient à la hauteur de la personne qui est morte. Parce que le but d’une cérémonie, c’est de marquer une transition, d’opérer une transformation. Si on n’investit pas ces endroits de rituel, il y a des deuils qui ne passent pas, il y a des mort·es qu’on n’arrive pas à laisser partir parce qu’on n’a pas fait ce qu’il fallait pour nous à ce moment-là. Magali Molinié parle très bien de ça dans son essai Soigner les morts pour guérir les vivants. Je pense que réenchanter la mort participe vraiment du bien-être de la société et du bien-être collectif. La manière dont on s’occupe de nos mort·es, c’est la même chose que la manière dont on s’occupe des malades, des personnes âgées, des enfants. Les crématoriums qui se construisent en banlieue à côté d’un Leader Price ou d’un Lidl, ça ne va pas. Comme il n’est pas possible de mettre des EHPAD dans des zones industrielles.Cela en dit beaucoup sur la société qu’on habite.
L.D. : Il y aussi une dimension comique dans ce spectacle, ce qu’on n’attend pas forcément d’un spectacle qui s’appelle Les corps incorruptibles et qui nous parle de la mort.
A.L. : C’est vrai. Je n’arrive pas à aborder les choses sans humour, je n’en suis pas capable. C’était important pour moi de qu’on ne soit pas dans le pathos, ni dans un rapport d’apitoiement. Dans mon enquête, je me suis retrouvée dans des situations bizarres, cocasses ; j’ai beaucoup ri. Quand la mort nous concerne de manière directe, nous sommes évidemment dans un rapport de tristesse, mais les fous-rires aux enterrements c’est connu, on le sait. Parfois, on est même très content que le prêtre ait mâché un mot, qu’il se soit trompé sur un nom, parce que cela nous ramène à une autre réalité que celle de la torpeur, de la sidération dans laquelle on peut être quand on perd un·e proche. On a beaucoup séparé la mort de la vie depuis le début du siècle, mais il y a eu une époque où on photographiait beaucoup les mort·es. C’était même une mode, et c’était important : on avait une photo à la naissance et une photo à la mort. Ce sont des choses qu’on gardait. On peut voir sur certaines un cercueil ouvert, avec 30 personnes autour, des enfants, des chiens, des chats... On fabriquait des bijoux funéraires avec des mèches de cheveux des mort·es. C’est très récent dans l’histoire de l’Occident qu’on interdise aux enfants d’aller aux enterrements.
L.D. : Vous organisez parallèlement régulièrement pendant les représentations, des rencontres autour de la mort...
A.L : Oui, j’aime bien le concept de cafés mortels qui a été inventé en 2004 par le sociologue et ethnologue suisse Bernard Crettaz, qui un jour a dit « là, il y a un problème. On ne parle plus de la mort dans les lieux publics et on en parle que en cachette. On ne donne plus de place à cela, il faut la remettre au coeur de la cité ». Il a ainsi lancé l’idée d’en parler au bistrot, collectivement, parce que cela a vraiment du sens d’en parler ensemble. Cela a mis un peu de temps pour venir en France. Il y a maintenant plusieurs coopératives funéraires dont celle de Rennes qui font un vrai travail auprès des publics, pour dire aux gens : parlons de la mort, réfléchissons à ce sujet. Ne faisons pas appel à n’importe quelles pompes funèbres. Faisons attention à ce sujet-là. Ce que j’aime faire est donc d’inviter des personnes qui travaillent dans le funéraire ou qui réfléchissent à la mort pour pouvoir repartir avec des infos qu’on n’arriverait pas à avoir par un autre biais. Et ce qu’on organise avec la Bastille, c’est une journée de la mort, une journée « colloque mortel ». J’aimerais qu’on puisse y parler de la possibilité de mettre en place une sécurité sociale de la mort, de celle d’habiller un mort, de peindre son cercueil, de fabriquer son urne... Investir du temps en réflexion et en accompagnement avec des gens plutôt que dans un rapport avec un service payant peut changer notre rapport à la mort. Il y a des gens géniaux qui travaillent dans le milieu funéraire aujourd’hui et qui n’ont pas forcément la parole.
(1)Revue Terrain n°62 « Des morts utiles »