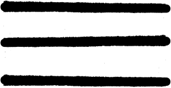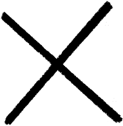Victor Roussel : Quelle place occupe la poésie dans votre vie aujourd’hui ?
Alberto Cortés : Aujourd’hui, elle occupe beaucoup de place. Mes textes, au début, avaient un aspect plus rationnel, puis j’ai commencé à flirter avec la poésie grâce à des ami·es à Málaga, où il y a une communauté poétique très riche, très jeune. À partir du moment où j’ai choisi d’être seul sur scène, avec le spectacle El Ardor en 2019, la poésie a pris de plus en plus d’importance jusqu’à tout dévorer. Je crois que la poésie fonctionne parfois comme un poison qui s’immisce petit à petit. Elle est arrivée progressivement dans mon travail, mais ce qu’elle a provoqué en moi a été très agressif, très violent, dans le sens où elle a transformé toute ma vision de la parole, de la vie et du théâtre. Elle a contaminé tout ce que je fais, ma manière de comprendre le langage et la scène. Je crois que c’est pour ça que je dirais qu’elle a fonctionné d’une manière virale.
V.R. : Depuis votre spectacle El Ardor, j’ai l’impression que vous avez compris comment vous pouviez habiter la scène. Comment avez-vous trouvé cette articulation entre le corps et la parole ?
A.C. : Avec El Ardor, j’ai commencé à chercher comment ne pas séparer la parole du corps. Cette pièce m’a aidé à comprendre qui j’étais quand j’étais seul, quand je fermais la porte de la salle de répétition. Ça a été une grande découverte, une sorte d’apparition : cette intimité soudaine avec la personne que je pouvais être. Quand je me mettais à parler, le corps parlait aussi. Et mon corps « pédé » [« marica »] s’est révélé. La parole, les gestes, l’homosexualité, tout s’est mélangé et j’ai compris que ça fonctionnait ensemble, que ce n’étaient pas des choses séparées. Dans Analphabet, cette quête d’identité se poursuit. Je continue à chercher une langue qui me serait propre, mais je ne crois pas être arrivé à un endroit d’où je pourrais dire : « ceci est mon langage ». Je crois que ce serait tuer le processus créatif, tuer aussi cette chose singulière d’être sur scène et de continuer à chercher ce qu’il peut s’y passer.
V.R. : Comment travaillez-vous cette tension entre l’écriture poétique et la présence brute ?
A.C. : Dans mes pièces, c’est presque comme s’il y avait un univers qui se créait à partir de couches successives de références littéraires et aussi de références pop — comme un palimpseste organique. Et ce mélange génère une sorte de matrice de langage. Pour moi, c’est important que le corps assume ces références, ces couches, et de sentir toutes ces influences qui cohabitent en moi, même quand elles ne sont pas visibles dans mon corps. Analphabet, c’est aussi le nom du fantôme que j’incarne sur scène. Ce nom n’implique pas l’effacement des références littéraires, mais me permet au contraire de les traverser avec un élan, une émotion brute.
V.R. : Vous incarnez un vampire dans El Ardor, un ange dans One Night At The Golden Bar et maintenant un fantôme dans Analphabet. Que vous inspirent ces figures fantastiques ?
A.C. : Je crois que toutes les références fantastiques, celles qui ont marqué l’enfant et l’adolescent que j’étais, qui dessinait, peignait, créait des histoires, ressortent maintenant. Et pour moi, ce ne sont pas vraiment des personnages, mais plutôt des alter ego, des présences qui s’invitent dans le corps et qui ressortent sur scène. Dans mon cas, ces figures apparaissent d’une manière un peu violente, mais aussi d’une manière, je dirais... tendre. On est tous un peu vampire, un peu ange, un peu fantôme aussi. Du coup, je crois qu’il y a une dimension ludique dans cette incarnation, un jeu avec cette mythologie-là. Mais l’idée de créer mes propres monstres n’était pas du tout consciente au début. C’est venu comme ça. Après coup, j’ai compris que ça avait aussi à voir avec l’idée du queer. Ce rapprochement entre la folie et l’altérité, entre soi et ce monstre en soi qui est un autre. Et finalement, en m’approchant de tout ce qui est monstrueux, fantastique, mythologique - tout ce qui n’est pas humain, pas d’ici, tout ce qui est “l’autre”, toujours rejeté - j’ai l’impression de me tenir sur le seuil, encore à la marge.
V.R. : Analphabet est un fantôme qui ressemble fort à une chimère, convoquant à la fois une certaine mystique andalouse et le romantisme allemand. Comment avez-vous écrit à partir de ces références littéraires ?
A.C. : Ce mélange entre l’allemand et l’andalou peut paraître étrange mais, en réalité, ce fût assez naturel. Dans mon héritage andalou, il y a une part de folie, d’excentricité qui est déjà un peu « pédé ». Cette sensibilité andalouse était déjà en moi et c’est en l’écoutant que je me suis rapproché du romantisme allemand. J’ai trouvé certaines connexions émotionnelles, notamment dans les manières d’aborder le tourment. Dans le flamenco, dans la musique copla(1), le tourment est l’impulsion principale, toujours d’une grande intensité. En lisant les poètes allemands, Novalis ou Hölderlin, en me rapprochant d’eux, j’ai été ému par cette façon plus contenue de vivre le tourment et d’aborder le sublime. Ce qui m’arrive souvent dans mes créations, c’est que je choisis de plonger dans un univers littéraire. J’ouvre une porte. Je m’approche d’un endroit que je voulais explorer depuis longtemps - un lieu qui m’appelait, qui était là, en attente, mais où je n’étais jamais vraiment entré. Parfois, je me dis même que mes pièces sont en fait un prétexte pour m’approcher de certains champs littéraires. Et pendant que j’écris, il y a une sorte de contamination qui se produit. En l’occurrence, le romantisme allemand a contaminé ma pensée, ma manière d’écrire. Je me suis approché de ces poètes pour qu’ils me salissent un peu, pour qu’il laissent une trace en moi. Et je crois qu’il y a quelque chose là-dedans : un grattement, une hybridation qui surgit de manière organique.
V.R. : En effet, votre présence est organique avant d’être cérébrale. D’ailleurs, vous dialoguez aussi avec l’apparence mélodramatique de certaines stars de la musique pop...
A.C. : C’est une autre référence fondamentale pour moi. Ce que j’aime le plus dans ma pratique, c’est d’osciller entre le haut et le bas. Je ne conçois pas la scène autrement. Je ne pourrais pas m’élever sans redescendre dans la boue, dans la terre, ni rester uniquement dans la fange sans chercher une certaine spiritualité. Je crois que cette tension, cette dualité, est précisément ce que je cherche à atteindre. C’est comme marcher sur un fil tendu entre les deux mondes : celui du mystique - être le médium de quelque chose - et celui de la matière, du terrestre, du charnel… Et puis la diva pop, c’est aussi un autre des monstres « pédés ».
V.R. : Analphabet est un spectacle où l’intensité de votre présence capte le regard, et pourtant ce n’est pas un solo. La violoniste Luz Prado est avec vous sur scène. Comment s’est
passée votre collaboration ?
A.C. : Depuis One Night At The Golden Bar, j’ai compris que la musique, jouée en direct sur scène, nourrissait vraiment mon travail. J’ai besoin que la musicalité de mon écriture soit transformée par un instrument, que ma parole soit mise en tension avec la musique et la lumière. Luz est une amie de longue date, on vient du même quartier à Málaga et on travaille ensemble depuis des années. C’était la personne parfaite pour m’accompagner dans ce spectacle. Au début, on s’est mis à chercher quel pouvait être le son de ce fantôme. On a beaucoup expérimenté, et petit à petit on a compris qu’il y avait deux dimensions : d’un côté, l’écoute en temps réel, qui se produit tout au long de la pièce, et fait émerger une corporalité, des sons presque fantomatiques. Et de l’autre côté, le cliché du violon, l’instrument romantique par excellence, le plus doux et le plus dramatique.
V.R. : Dans les arts, aujourd’hui, le queer est une esthétique qui est vécue très positivement, comme une force de transformation et d’espoir. Mais dans Analphabet, j’ai l’impression que vous allez un peu à contre-courant, que vous exprimez plutôt la violence, le machisme, le danger...
A.C. : C’est un endroit très dangereux, en effet. Je n’étais pas sûr qu’on puisse vraiment l’habiter en conscience. Mais je crois qu’une partie de mon travail consiste justement à réfléchir à ce que signifie être pédé. Et cela implique aussi de se regarder soi-même, de se questionner, de chercher à s’améliorer, de repenser certains aspects, certaines manières de faire… Le danger est évidemment d’être mal interprété, ou que le spectacle soit récupéré par un regard d’extrême droite et devienne une excuse pour dire : « Ah, tu vois ? Les pédés sont extrêmes, violents, dérangés… ». Alors je sens que ce sont peut-être des choses qu’on doit seulement dire entre nous, entre « pédés », à huis clos, ou avec nos allié·es, et avec beaucoup de précaution. Une partie de mon travail est donc une invitation à la communauté gay pour repenser certains lieux, certaines pratiques qui sont peut-être trop violentes. Dans Analphabet, précisément, je traverse les violences machistes qui existent aussi dans le milieu gay, les violences marchandes et sexuelles, la brutalité qu’il peut y avoir dans certains lieux de drague quand ils ne sont pas traités avec soin. Ce n’est pas un travail puritain, pas du tout, je ne dis pas qu’il faut arrêter de baiser ! Mais il s’agit de continuer à questionner notre masculinité. Ce n’est pas parce qu’on est queer qu’on se débarrasse du machisme. On le devrait, mais la structure sociale ne le permet pas complètement. Et c’est là, je crois, la grande pierre d’achoppement : nous restons des hommes, et il faut regarder en face tout ce que cela implique, et notamment ce poids patriarcal que nous portons encore, même si, paradoxalement, nous aimons les hommes. Cetravail, d’une certaine manière, a aussi un lien avec le féminisme — il s’appuie sur cette perspective, sur cette manière de voir.
V.R. : Vous parlez aussi beaucoup du paysage comme territoire intime avec, à la fin du spectacle, une note d’espoir et de tendresse. L’ambivalence du désir, l’érotisme, peuvent-ils être, selon vous, une forme de résistance politique ?
A.C. : Si je questionne ces territoires et ces pratiques intimes, c’est que je crois en la force du désir. Et je le fais aussi parce que je crois important de mettre la fragilité et la vulnérabilité au cœur de nos vies. Oui, je crée un paysage où la vulnérabilité et la fragilité sont une puissance queer. Cela me donne de l’espoir, cela me maintient en lutte.
V.R. : Quelle place donnez-vous alors au regard des spectateurices ?
A.C. : Dans mon écriture et sur scène, je considère le public comme mon amant, mon compagnon. Analphabet est un exercice d’amour et de séduction. Mais c’est une relation tantôt respectueuse, tantôt ambiguë car mon adresse est à double sens : le « tu » auquel parle le fantôme Analphabet, c’est le public, mais c’est aussi l’amant abusif dont je suis toujours amoureux et que je rejette à parts égales. Il y a une tension entre l’amour et l’abus, parfois presque sadomasochiste. Ce n’est pas une pièce pour condamner quelqu’un, mais pour pointer, dans mon histoire personnelle, toutes les contradictions à vouloir vivre une relation avec une personne violente.
V.R. : Vous avez longtemps créé à la marge et, depuis peu, vous jouez vos spectacles partout en Europe. Qu’est-ce que cela vous inspire ?
A.C. : Toute ma vie je l’ai passée à la marge. Je vis dans un quartier périphérique, dans une région qui est elle-même à la périphérie de l’Espagne et de l’Europe. De cette place qui est la mienne, je garde une méfiance pour le centre, et je crois que cela me traverse toujours, de façon un peu inconsciente sans doute. Maintenant cela se passe mieux pour moi, je travaille davantage, mais je ne suis pas dupe du succès. Je joue dans plusieurs pays, j’essaye de comprendre comment fonctionne le marché culturel européen. Jusqu’où je veux jouer le jeu du système ? Qu’est-ce que j’accepte de sacrifier ? Je me pose toutes ces questions et je garde une certaine ironie. Mais il y a de la peur aussi, peur que cela me dépasse et finisse par me dévorer. Peur de cet usage mercantile de l’art : maintenant c’est mon tour, je suis à la mode, et puis rapidement ce sera un·e autre artiste, et je serai de nouveau rejeté à la marge. Les vampires et les fantômes font aujourd’hui partie de l’imaginaire capitaliste, mais ils sont supposés être des outsiders, ce sont les autres, celleux qui sont à l’écart. Comment faire en sorte que des figures et des récits populaires ne se réinventent pas seulement pour l’argent ? Ces pensées, ces peurs, apparaissent certainement dans mon écriture.
(1) La copla est une musique populaire, issue du folklore espagnol, héritière des anciennes romances qui ont servi au peuple pour dénoncer les abus, décrire les coutumes, raconter des histoires plus ou moins vraies et surtout parler d’amour, de jalousie et de déception amoureuse.
Les textes de ses spectacles seront publiés grâce à un travail de traduction de Marion Cousin, qu’Alberto Cortés remercie de tout cœur. Analphabet est à paraître en avril 2026 aux éditions Les Solitaires intempestifs