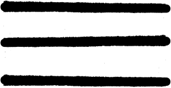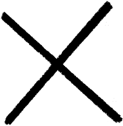Laure Dautzenberg : Comment vous êtes-vous rencontrés ?
Gurshad Shaheman : La première fois, c’était au Phénix, à Valenciennes, lors du Cabaret des curiosités. Dans le cadre d’un partenariat que le Théâtre avait avec le Festival TransAmériques de Montréal, des artistes québécois étaient invités afin de créer un maillage avec des artistes européens. Après, on s’est revus à Montréal quand je jouais Pourama Pourama.
Dany Boudreault : Puis on a participé tous les deux à un festival de formes courtes au Théâtre des Tanneurs, à Bruxelles. On s’est rencontrés en coulisses, dans les loges, à plusieurs reprises. Quand j’ai repris l’avion pour Montréal, j’ai écrit à Gurshad. Je savais que l’année d’après, j’allais revenir, et je lui ai dit qu’on devait faire quelque chose ensemble.
G. S. : De mon côté je trouvais qu’il y avait vraiment des filiations dans nos démarches respectives. L’année d’après, Dany est revenu à Bruxelles où j’habitais alors. On s’est donné rendez-vous dans un café, on a discuté trois heures, et nous avons décidé de faire ce projet d’enquête mutuelle.
D. B. : C’est vraiment né d’une espèce de fascination. J’étais très intrigué par l’écriture de Gurshad, par son travail évidemment, sa présence indéniablement, mais je trouvais qu’il y avait des échos, des correspondances dans notre façon d’écrire, de voir le texte au plateau.
L. D. : Vous avez chacun enquêté dans la vie de l’autre, passée et présente. À partir de votre enquête, comment avez-vous tissé l’écriture de ce spectacle ?
G. S. : Lorsque nous nous sommes retrouvés après nos enquêtes, on avait environ mille pages de matériaux à nous deux, c’était vraiment colossal... Très vite, nous avons vu que l’ordre chronologique des rencontres ne marchait pas. Nous avons donc opté pour un chapitrage en fonction des lieux de rencontre, qui est une forme de voyage vers la famille.
D. B. : Cela fonctionne comme un entonnoir, dans une structure en quatre chapitres. C’est vraiment devenu une écriture à quatre mains, dans un aller-retour plus instinctif que je ne l’aurais cru, très organique.
G. S. : Nous avons créé par soustraction et non par accumulation, ce qui donne une densité au texte. Il y a des regrets, mais on n’a rien sacrifié de l’essence des choses. On a aussi beaucoup fait « rentrer une figure dans une autre » si je peux le formuler comme cela. Par exemple, Dany a deux soeurs dont les récits se complètent. La question était non pas de fusionner les deux, mais de faire entrer la parole de l’une dans la parole de l’autre de manière à ce qu’il y ait un rassemblement thématique. Les deux figures sont souvent mêlées mais elles ne sont pas confondues.
D. B. : C’est là où il s’agit de fiction et de dramaturgie. Parfois il fallait synthétiser des choses très complexes, et accélérer le temps, et parfois on l’a fait se suspendre sur un événement très simple. Ce n’est pas une écriture théâtrale, c’est vraiment de l’écriture romanesque, c’est une recherche de restitution de sensations et de description de faits.
G. S. : On s’est aussi souvent demandé s’il n’y avait pas une trame fictionnelle à ajouter. Nous avons longtemps pensé que le contexte fictionnel pouvait être un mariage, un discours que j’adressais à Dany, ou qu’on avait écrit cela pour les funérailles de l’autre. Et puis finalement, ce qu’on a gardé, c’est peut-être que nous nous retrouvons un an plus tard à Sarajevo, où nous nous sommes rendus avec Dany en octobre 2022 pour poser les bases de la pièce.
L. D. : Le spectacle commence et finit justement là, à Sarajevo. Pourquoi avoir choisi cette ville ?
G. S. : Le séjour à Sarajevo n’était pas censé faire partie du récit, c’était notre voyage de brainstorming. On cherchait un endroit dont on ne parle pas la langue. On voulait aussi être un peu perdu pour mieux se découvrir.
D. B. : C’était une façon de mieux se connaître au-delà de l’artistique. Humainement, nous voulions voir comment cela circulait entre nous. De façon très intuitive, nous avions le désir d’aller dans un lieu que nous ne connaissions pas, ni Gurshad ni moi. Sarajevo est une ville marquée, mais avec laquelle nous n’avions pas de lien intime. D’une manière irrationnelle, je crois que nous voulions aller dans une ville de trauma, mais en même temps une ville où l’on avait entendu dire qu’il se passait des choses artistiquement. Et très vite on a été frappé, comme le texte le dit, par la présence de la mort et du silence.
G. S. : Ce qu’on a vécu là a été tellement fort, la découverte des stigmates de cette ville résonnait tellement avec l’histoire de l’un et de l’autre que finalement, la pièce commence et se termine à Sarajevo. Sans compter que j’ai été très marqué, dans les années 90, par le siège de cette ville, la guerre qui à nouveau était si proche de nous.
D. B. : Cette guerre a vraiment marqué nos imaginaires d’adolescents. Il y avait toute cette notion de limite entre Orient et Occident aussi, cette idée de frontière qu’on essaie de brouiller.
L. D. : Le dispositif est très particulier puisque le public choisit quel récit écouter...
D. B. : Cette idée a vraiment jailli lors de notre résidence en novembre 2023 au Théâtre Prospero à Montréal, un jour où Gurshad est arrivé avec cette proposition.
G. S. : Au départ, cela devait être deux monologues successifs. Mais après avoir fait notre enquête, quand on s’est retrouvés avec nos mille pages de texte, cela ne marchait plus. Et il y avait quelque chose dans la forme frontale, un peu classique, qui ne me satisfaisait pas. Je cherchais une manière plus juste de faire entendre ces récits-là. Il y a toujours quelque chose qui m’intéresse dans le fait de mettre en scène la parole perdue, des paroles qui se recouvrent. Sur tes traces parle des différentes versions d’une même histoire, comment sa propre version n’est pas la même que celle de sa famille, de ses différents membres... Le dispositif d’écoute simultanée met les spectateurices face à cela.
D. B. : Ce rapport à l’échec du langage est aussi quelque chose qui m’intéresse beaucoup dans l’écriture. Ici, même l’écoute des spectateurices peut être déjouée.
L. D. : Gurshad, vous parlez souvent d’expérience. Quelle est celle que vous espériez de ce spectacle ? Et pour vous et pour les spectateurices ?
G. S. : Le dispositif nous met dans un état performatif très particulier. J’aime énormément cette traversée, cet état d’hypnose, de transe, dans lequel je plonge. C’est une espèce de temps suspendu ; ce sont deux heures de ma vie où je suis ailleurs. Après, pour les spectateurices, personne ne voit la même chose et c’est ce que nous visions avec Dany : qu’à la sortie, les gens parlent et complètent le puzzle les uns des autres.
D. B. : Je pose toujours la même question quand je sors de scène : Vous avez beaucoup zappé ? Vous vous êtes beaucoup baladé ?
Je trouve que c’est de cet ordre-là : les gens se promènent.
G. S. : C’est le récit qui amène cela aussi, cette construction en tiroirs, ce côté Shéhérazade.
L. D. : Le dispositif rend ce spectacle à la fois très offert et très pudique...
G. S. : Cela tient au dispositif, mais aussi à l’adresse. Je fais
l’enquête pour Dany, pas pour une personne tierce ; sa mission est de me rapporter des choses, à moi. À partir de là, il ne pouvait pas y avoir d’adresse directe au public. Les spectateurices sont dans une position un peu voyeuse et « entendeuse ». Comme dans Fenêtre sur cour d’Alfred Hitchcock : nous sommes dans un appartement et le public ne regarde pas par la fenêtre, avec des jumelles, comme James Stewart, mais entend avec un casque une conversation extrêmement privée. L’adresse est construite dans ce sens-là.
L.D : C’était quand même se faire une immense confiance que de se livrer ainsi mutuellement les clés de votre passé...
D. B. : Oui, mais il n’y a absolument rien dans ce que Gurshad a écrit avec lequel je ne suis pas d’accord et inversement. Chacun avait un droit de regard sur la partition de l’autre, c’était capital. Et nous sommes toujours restés assez pudiques avec ce que les gens nous ont confié.
G. S. : Nous avions deux règles : « Je ne dirais rien sur toi que tu n’aies pas absolument validé et tu n’écouteras jamais les enregistrements des entretiens de tes proches ». Mais, surtout, le pacte qu’on ne dit pas dans la pièce, c’est qu’il y avait une mission de réparation. Dany disait « Moi je ne sais pas pourquoi on a perdu la ferme », et moi je disais : « Je vais le découvrir et je te ramène la réponse ». De mon côté, comme je le dis dans le prologue, je ne peux pas retourner en Iran, alors je voulais que Dany le fasse pour moi parce qu’aujourd’hui j’ai l’impression que cela va réparer quelque chose d’un traumatisme passé. Il s’agissait de faire des missions compliquées, pour réparer l’autre mais parfois aussi pour réparer l’entourage. Il y a cette amie avec qui Dany est brouillé : « Moi elle ne veut plus me parler, mais si tu peux la voir, dis-lui que je m’excuse ». Dany, lui, est allé rencontrer mon oncle qui ne me parle pas depuis sept ans. Il y a vraiment quelque chose du soin dans le projet, le soin que l’on prend l’un de l’autre et le soin que l’on prend des récits qu’on nous transmet. À partir de là, il est évident qu’on ne pouvait rien laisser dans le texte sans l’accord absolu de l’autre.
D. B. : Nous étions des émissaires, des ambassadeurs. C’était très délicat, parce que cela implique des gens. Mais réparer, le mot est très juste. Et nous avons eu comme grande préoccupation de ne pas exotiser l’autre, comme représentant du Québec et de l’Iran, du Moyen-Orient. La question autochtone, très prégnante aujourd’hui au Canada, intriguait beaucoup Gurshad. Le Canada est dans un processus de réconciliation avec les Premières Nations et c’est quelque chose qui est partout, même de manière invisible. C’était intéressant de mettre la lumière là-dessus, du moins du point de vue de Gurshad, au même titre que moi, j’ai rencontré des réfugié·es. en Turquie. Ce ne sont pas des gens proches de l’un ou de l’autre, mais ils nous sont lié·es par l’histoire.
G. S. : Il y a les blessures personnelles et il y a ce qui n’est pas réparé à une échelle plus grande. La question était : comment aller chercher les bons témoins, créer le lien possible pour que ces paroles-là, qui nous tiennent à coeur, puissent être entendues, au même titre que nos histoires intimes.
L. D. : Il y a une tension entre un récit très fluide, très incarné, qui se dit à notre oreille, et une dimension plus fantomatique qui se déploie sur le plateau...
G. S. : Une fois que nous avons élaboré le texte, il restait à écrire la partition visuelle, ce qui est complètement autre chose. Toutes les images que l’on voit sont des sortes d’émanations du texte et parfois des émanations fantômes, issues de parties coupées.
D. B. : Les images ont surgi de façon assez instinctive au plateau. Il fallait qu’elles soient dilatées et en dissociation, pour laisser de la place au récit. Le travail a beaucoup consisté à équilibrer, calibrer les textes, les images, les textures, les tonalités.
L. D. : Comment avez-vous pensé cette scénographie avec cet appartement-gigogne qui se dessine derrière un voilage ?
G. S. : On s’est beaucoup demandé dans quel espace la parole s’inscrirait parce que ces deux monologues sont hors sol. Et comme le dispositif d’écoute exige une concentration particulière, nous voulions qu’il n’y ait pas davantage d’abstraction dans la scénographie, que tout soit extrêmement lisible immédiatement, ce qui permet aux spectateurices de voyager plus facilement.
D. B. : Iels ont accès à un endroit ancré dans le réel. Nous voulions également que l’espace permette d’installer certaines dynamiques relationnelles en apparence réalistes pour mieux décoller du réel quand les récits se déploient. Par ailleurs, chaque pièce, chaque mur est une frontière, et cet espace, cet intérieur-là peut se décliner de façon polysémique et devenir toutes sortes de pays, de territoires. Construire le décor comme un aquarium où on nous regarde juste vivre, occupés à des actions du quotidien, nous semblait une bonne manière d’incarner la question de la pudeur et du dévoilement qui irrigue la pièce et résulte du pacte de départ.
G. S. : L’idée de l’appartement vient aussi du fait que maintenant, quand on réserve un appartement de location lors de nos voyages, les logements se ressemblent tous, souvent on se retrouve dans des sortes « d’appartements témoins ». L’appartement que nous avions loué à Sarajevo aurait pu tout aussi bien se trouver à Marseille ou à Montréal. Avec des variantes, évidemment, mais c’était un intérieur générique avec des éléments de déco clichés comme un poster de Jim Morrison par exemple. On s’est dit que pour la scénographie, c’était le bon cadre : c’est à la fois l’appartement de Sarajevo où nous sommes partis ensemble pour nous connaître davantage, mais aussi tous les appartements où nous avons vécu, où nos familles ont vécu, les appartements où l’on rencontre les gens, où défilent les hommes...
L. D. : Vous vous déshabillez, vous vous rhabillez. Il y a le costume militaire, la mariée, etc. Quelle était votre parti pris dans ce rapport aux vêtements et aux costumes ?
G. S. : C’est le résidu de beaucoup d’étapes de réflexion. Au début du travail, Dany et moi devions être les seuls interprètes sur scène et à un moment donné, on s’est dit qu’il serait bien que quatre autres acteurices soient avec nous pour incarner les différents figures du récit : une jeune femme, une femme âgée, un jeune homme, un homme âgé, qui prendraient en charge à la fois les oncles, les mères, les soeurs, les meilleur·es ami·es, les amants, etc. On envisageait que ces figures puissent passer dans le récit dans des espèces de scènes muettes. Et puis quand on a opté pour le dispositif des casques, cela a éliminé la possibilité budgétaire qu’il y ait d’autres acteurices avec nous. Mais on avait tellement rêvé ces figures qu’on s’est dit qu’on allait les incarner nous-mêmes. Ainsi, je suis la mère mais aussi la tante, le soldat qui revient de guerre pour Noël et qui décore un sapin avec son enfant...
D. B. : Comme à l’écriture, cela a souvent surgi au plateau de manière instinctive, très naturellement. Mais je savais aussi que le changement de costume lui-même a la même importance, sinon plus, que le résultat. Je pense qu’il y a une espèce de mue comme ça, permanente.
G. S. : Oui, c’est cette idée qu’on est traversé, puisque nous portons la voix de plein de personnes. Et en même temps, à force de porter les voix, cela modifie nos corps. On épouse finalement aussi les silhouettes des personnes qui parlent à travers nous.
L. D. : Au Théâtre de la Bastille, vous ouvrez une saison consacrée aux identités performées. Pour vous, comment Sur tes traces résonne avec ce thème ?
D. B. : Je ne crois pas à une identité arrêtée mais aux contours brumeux de nos êtres. C’est pour cela que je fais du théâtre et je pense qu’il faut toujours réaffirmer ce que l’on est, ce que l’on veut. La seule chose qui m’intéresse, c’est de me déplacer, me décentrer par rapport à ce que les autres me renvoient comme mon identité. Vous pensez m’écouter ? Mais je parle de quelqu’un d’autre. Vous croyez que je vais dire ça ? Mais je dis quelque chose d’autre. Vous croyez que je vais juger cette situation, mais non. Elle est là, la performance de l’identité.
I contain multitudes, comme le dit Walt Whitman. Nous sommes traversés par les fantômes de gens présents, absents. On veut toujours me travestir dans les spectacles, et je le fais pour le travail, mais cette fois, c’est né d’un désir profond, pour justement jouer avec l’expression du genre, jouer avec certains outils.
G. S. : Il y a également une chose très importante : je me vis comme une personne queer, mais, comme la plupart des personnes queer, je suis issu d’une famille hétéronormée et c’est aussi cela que la pièce brasse. Nous sommes faits de cette histoire-là, nous sommes les produits d’éducations très normatives. Moi qui me considère comme non-binaire, j’incarne dans cette pièce des archétypes de figures très genrées : la mère, le père, le marié. Je suis à la fois moi, à la fois traversé par Dany et toutes les figures de la vie de Dany, et en même temps par des figures extrêmement codées qui sont des espèces d’émanation de la famille, celle-ci n’étant qu’un microcosme de la société. Dans Sur tes traces, nous performons donc nos identités et toutes les identités qui nous ont fabriqués.
D. B. : C’est aussi une question nationale. En termes politique, c’est très important dans le spectacle. Moi je parle en tant que québécois. Je suis canadien mais je viens d’une famille indépendantiste, et c’est aujourd’hui une histoire très compliquée celle de l’indépendance du Québec. Le texte est aussi une réflexion sur les assignations. Ma posture au monde, et je pense que c’est la même pour Gurshad, est qu’on n’appartient pas nécessairement aux choses qu’on voudrait nous faire croire.
G. S. : L’identité genrée est celle qui surgit en premier, mais il y a effectivement toute la question de l’appartenance à une terre, à une culture, à une nation, à une langue, à une patrie. Ces questions-là traversent tout le récit.
D. B. : Dans le chapitre deux, en Turquie, j’ai un débat avec mon traducteur, Saeed : est-ce-que le poète Rumi est turc ou perse ? C’est un grand sujet de dispute entre les Turcs et les Iraniens, parce qu’il est mort à Konya, en Turquie et qu’il est né en Afghanistan, alors dans l’empire perse.
G. S. : Et aucun des deux lieux n’est dans l’Iran actuel. Le plus grand poète iranien est ainsi né en Afghanistan, mort en Turquie. Donc il est de quel pays en fait ? Cette question-là, que Dany pose dans la pièce, traduit très justement le tiraillement que je ressens et en tout cas l’impossibilité de répondre à cette question à laquelle on est sommé de répondre parce que cela doit être marqué sur la carte d’identité, d’où tu viens, à quel pays tu appartiens.
L. D. : Il y a dans cette pièce une traversée des émotions, des sentiments, qui n’épargne rien mais dégage une pulsion de vie très forte...
G. S. : L’ombre de la mort plane sur toute la pièce et est en effet contrée par un instinct de vie très fort. La seule réponse que nous avons à notre condition de mortel, c’est la joie. Je n’ai pas d’autre réponse que ça : récupérer un maximum de joie tant que c’est possible, et tant mieux si cela se ressent dans la pièce parce que les thèmes abordés sont durs. Il y a la guerre, les instincts d’autodestruction ; on parle du sida, d’épidémie… Nous avons en commun Dany et moi, un instinct de survie très fort. Il y a aussi l’idée que le travail va avec la joie, car celui-ci nous permet de modeler un réel qui ne nous convient pas, pour en faire une oeuvre qui nous convienne. Tout le mal, nous nous en servons pour en faire une chose fabriquée à partir de cela, qui ne le guérit pas, mais qui le nomme et qui le transforme.
D. B. : Dans l’écriture, nous avions la préoccupation de ne jamais nous apitoyer, de travailler toujours en contradiction, sans s’étendre, sans se complaire. D’ailleurs c’est ce que dit Gurshad dans le chapitre quatre : « Tu me confies tout ceci sans tristesse », et c’est vrai. Évidemment, il y a de la tristesse, mais il faut qu’il y ait de la joie.
G. S. : Avec ce qui se passe au Moyen-Orient ces dernières décennies, un danseur libanais de baladi, Alexandre Paulikevic, revendique la danse comme acte de résistance. Je me reconnais énormément dans cette pensée.